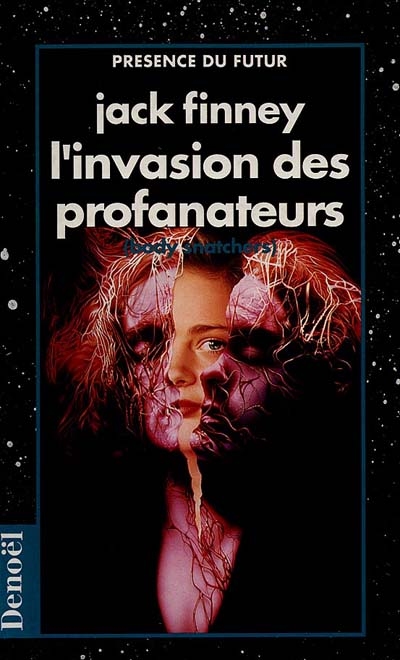Bigre, je ne savais pas qu'Ende s'était intéressé à l'anthroposophie

Merci pour tous ces liens !
Le billet de blog sur Momo a écrit : par exemple dès le premier chapitre du livre, lors d’une discussion entre Momo et son meilleur ami, tu as une allusion discrète à la doctrine de la réincarnation, lorsqu’il est fait mention que ce sont eux-mêmes qui ont construit autrefois le vieil amphithéâtre où ils discutent aujourd’hui.
Je viens de relire le chapitre 1 et je me suis usé les yeux sur les pages pour retrouver la supposée allusion, dans un chapitre qui d'ailleurs ne met pas en scène le meilleur ami de Momo puisqu'il relate la découverte de Momo par les gens de la ville et l'aide qu'ils lui apportent pour qu'elle reste dans le théâtre.
Après relecture-feuilletage, le passage dont le billet de blog semble parler se trouve en réalité au chapitre 4. Beppo Balayeur, en parlant à Momo dont il est effectivement le meilleur ami, évoque un moment où il balayait un vieux rempart et a eu un genre de souvenir en voyant cinq pierres disposées en forme de T : il se persuade que ce sont lui-même et Momo qui ont mis ces pierres-là en construisant le mur, dans "les temps d'autrefois". Le sens du passage reste très vague : on peut le comprendre aussi bien comme un rêve éveillé ou une hallucination d'un personnage constamment présenté comme fantasque, que comme une allusion à sa croyance en une immortalité oubliée, ou à un voyage dans le temps, ou encore en une réincarnation, mais rien n'est affirmé sur ce dernier sujet. Le passage peut se comprendre aussi bien comme une "mémoire des lieux" assez classique en SF et en fantasy : personnellement, ça me rappelle autant les
Chroniques martiennes de Bradbury ou la Route dans
L'Assassin royal de Hobb. À cette différence qu'effectivement, dans
Momo, ce passage ne semble pas s'intégrer étroitement à la suite de l'intrigue, en dehors du thème général du temps, mais il faudrait que je relise ce roman (ma lecture date sérieusement).
Je n'ai pas le temps de creuser les autres passages cités là tout de suite, mais je vais les relire aussi. C'est certainement en partie parce que j'adore
L'Histoire sans fin depuis très longtemps et que
Momo m'a beaucoup plu aussi, mais même en admettant que
Momo contienne des allusions à l'anthroposophie, si elles sont aussi rares et discrètes que ce que mentionne le billet, ça donne une base assez fragile pour considérer le roman comme de la propagande. Non seulement on est très loin d'une brochure pour une secte à la façon des romans de Ron Hubbard pour la scientologie, mais l'ensemble des détails mentionnés dans
Momo fait sens au sein du roman sans qu'on ait besoin de se référer à autre chose qu'à des figures et à des procédés assez classiques de la
fantasy jeunesse. Par exemple, les banquiers du temps qui donnent froid quand ils s'approchent, c'est une reprise d'une propriété des fantômes et autres spectres vieille comme le monde.
Je pense qu'en définitive on en revient à la classique question "l'homme et l'œuvre". En termes d'œuvre, on peut largement lire et faire lire
Momo sans endoctriner les gens. En revanche, je deviens très curieux de savoir si, en termes financiers, les ayant droits actuels de Michael Ende soutiennent toujours l'anthroposophie ou non. Si oui, là, ça devient un motif pour ne plus leur rapporter de sous.
Bon, c'est assez rude comme critique d'Ende, et je vais mettre du temps à digérer ça. Mais il faut que je me documente. Merci beaucoup en tout cas pour l'avertissement, il faut que je me mette au courant en tant qu'enseignant.
Edit : apparemment, ce sont les parents de Michael Ende qui l'ont inscrit dans une école Waldorf à Stuttgart en 1947, selon
le site de Michael Ende.